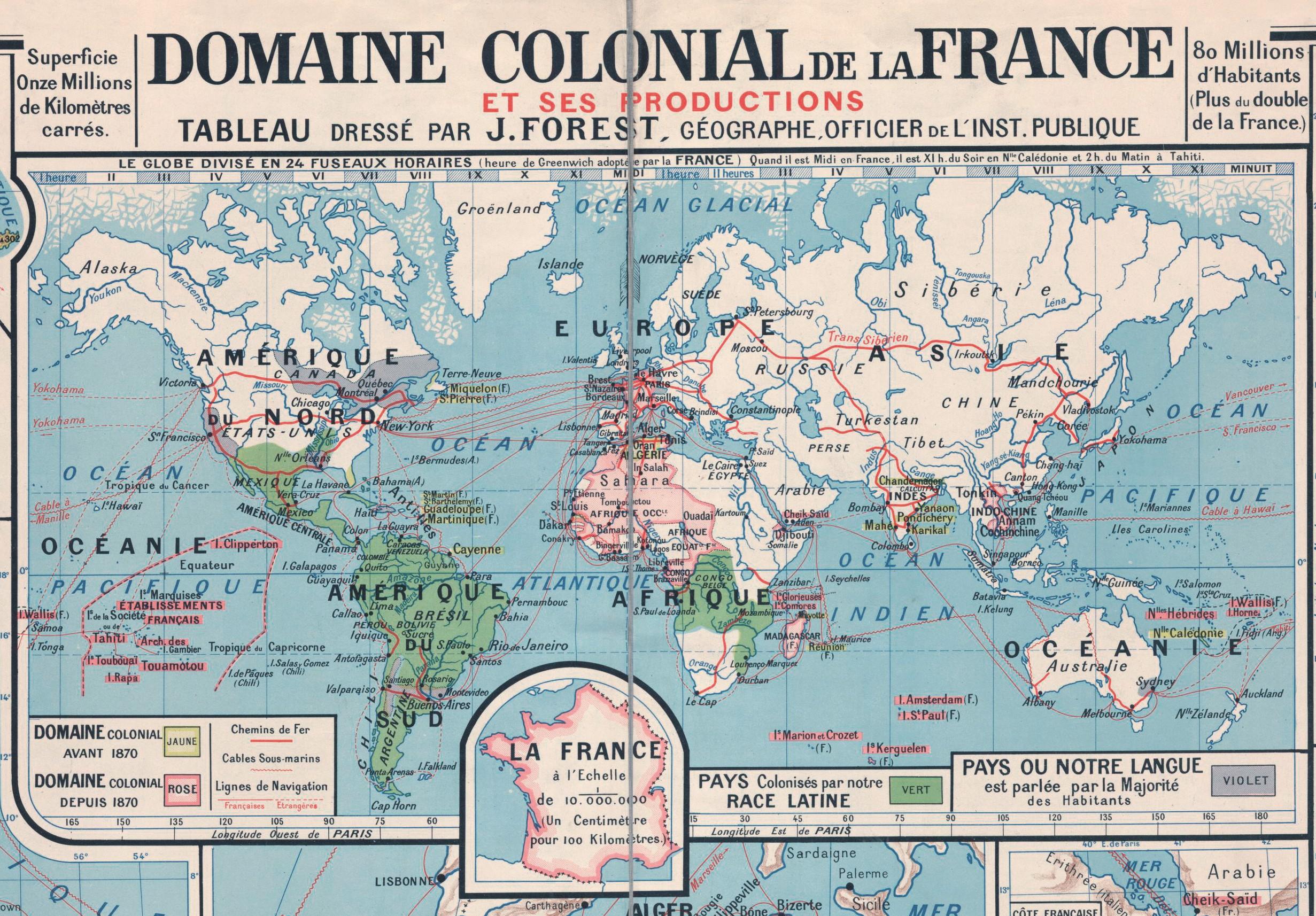- Enseignant: Stephane LOJKINE



Après la déroute de l’aventure encyclopédique et son échec au théâtre, Diderot, sur la proposition de son ami Grimm, se lance dans la rédaction de comptes rendus des Salons, les expositions que l’Académie royale de peinture, au dix-huitième siècle, organisait tous les deux ans au Salon carré du Louvre. Présentés comme des lettres familières écrites à Grimm, les Salons de Diderot étaient diffusés dans la Correspondance littéraire, un journal manuscrit qu’il destinait à une poignée d’abonnés princiers des cours de l’Europe du nord et de l’est.
Diderot se prend au jeu et, des quelques pages du Salon de 1759, passe à des volumes en 1765 et en 1767. Pourtant, au départ, il sait très peu de choses sur la peinture, à laquelle il ne s’est intéressé que de fort loin dans l’Encyclopédie. C’est à partir de son expérience de théoricien du théâtre qu’il aborde la scène picturale, et c’est à l’efficacité dramatique de la composition qu’il est d’abord sensible. Mais la peinture résiste à une modélisation purement théâtrale : Diderot va découvrir progressivement ce qui, dans la peinture, résiste à la scène. Autour de cette résistance se dessine la voie diderotienne vers l’esthétique : une voie contradictoirement platonicienne et matérialiste, aux antipodes de l’esthétique kantienne.


« Le trou de l’ozone au-dessus de nos têtes, la loi morale dans notre cœur, le texte autonome peuvent, séparément, intéresser nos critiques. Mais qu’une fine navette ait attaché le ciel, l’industrie, les textes, les âmes et la loi morale, voilà qui demeure insu, indu, inouï. » – écrit Bruno Latour dans Nous n’avons jamais été modernes. - Si l’un des traits de notre supposée « modernité » est bien de séparer sciences, littérature, et morale ou politique, nous partirons en revanche du postulat que la résistance aux crises écologiques implique de sortir la littérature de son isolement souverain, et d’assumer son nouage avec les différentes formes instituées du savoir comme avec la pluralité des modes et moyens d’agir. Le séminaire se donnera donc pour objectif de suivre quelques tours de cette « fine navette » qui unit sciences des choses, pratique du texte et souci de l'action. A travers deux questionnements majeurs : « Que peut la littérature ? » et « Que savoir du monde ? », nous tenterons d’articuler une double exigence : celle d’une interrogation réflexive sur les impacts de l’écriture, et celle d’une prise en considération des modes de connaissance dans leur diversité (biologique, historique, juridique …).

Dérèglement climatique, catastrophes environnementales, impact planétaire des activités humaines, biodiversité en voie d’extinction : autant de sujets massivement entrés dans le champ littéraire depuis quelques décennies qui donnent lieu à de nouveaux discours et à de nouvelles topiques engageant le rapport entre réel et fiction et questionnent nos représentations sociales, économiques et politiques comme littéraire. L’écocritique se propose d’analyser ces textes dans lesquels la nature, l’environnement, les non-humains, etc. ne sont pas seulement des décors ou des prétextes mais les fondements mêmes du récit et de ses enjeux.
Cette étude donne pour double objet d’interroger un faire littéraire (poiein) ou un discours (logos) sur notre « maison » (oikos) et de sortir l’analyse critique des limites des littératures nationales comme des genres et des disciplines : un texte est indissociable de son contexte. L’objet de ce cours est de proposer une histoire de ce courant critique et de ses textes fondateurs (écocritique, écopoétique, écoféminisme), afin d’étudier en quelle mesure une telle approche critique, transnationale, transdisciplinaire et transmédiatique, enrichit notre analyse de textes de fiction en tant que producteurs de mondes.
Ce cours dont la méthode nous fera passer d’un « lire » à un « écrire » est pensé en lien étroit avec le cours « Situation de l’écriture » de Jean-Christophe Cavallin.
Bibliographie : • Séverine Kodjo-Grandvaux, Devenir vivants, éditions Philippe Rey, 2021 • Jean-Christophe Cavallin, Valet noir. Vers une écologie du récit, éditions José Corti, 2021 • The Ecocriticism Reader, Landmarks in Literary Ecology, ed. by Cheryll Glotfelty & Harold Fromm, Athens and London, The University of Georgia Press, 1996. • Écopoétiques, Alain Romestaing, Pierre Schoentjes et Anne Simon (dir.), Fixxion, n° 11, 2015 (en ligne) • Stephanie Posthumus, French Ecocritique. Reading Contemporary French Theory and Fiction Ecologically, University of Toronto Press, 2017.
(Image : Salzburgo, 1977 © Luigi Ghirri)

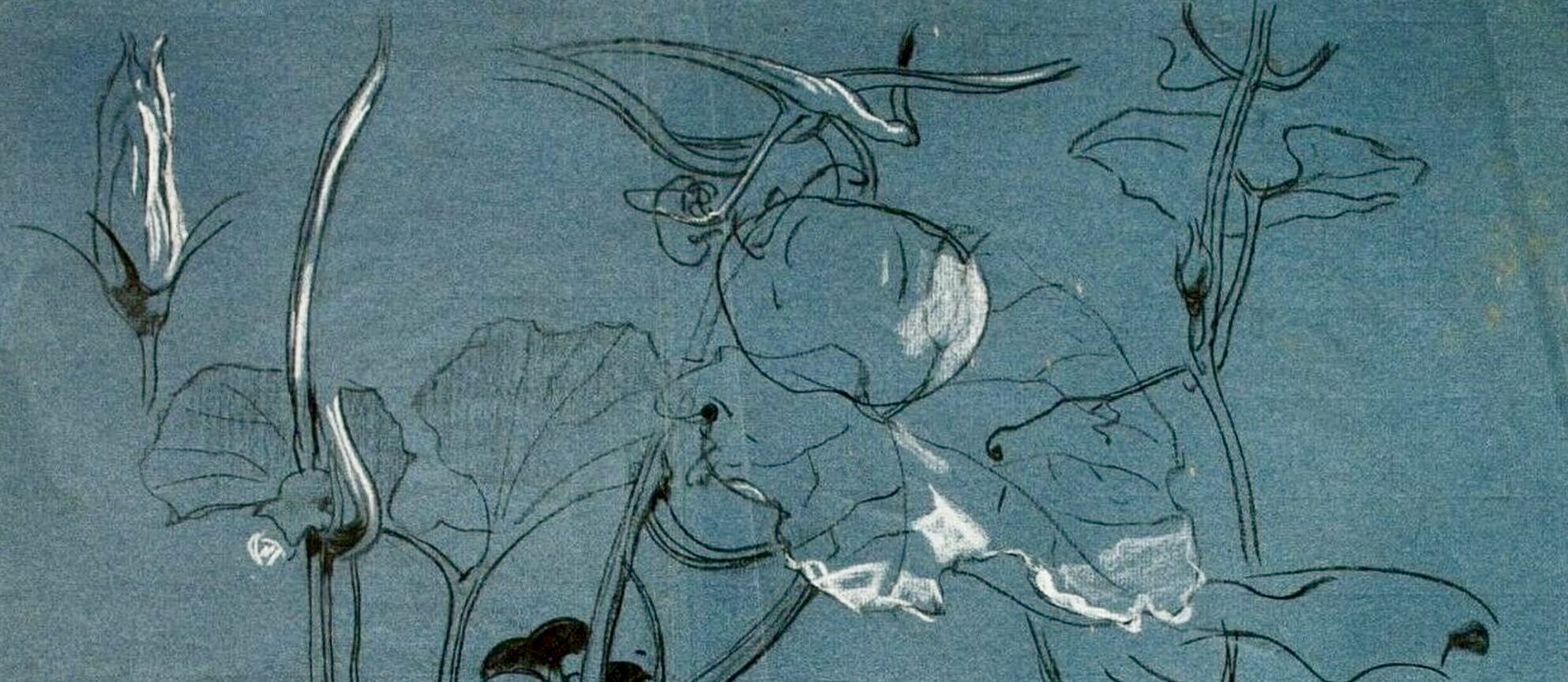
« Je n’ai plus envie de me marier avec personne, mais je rêve encore que j’épouse un très grand chat. » (Colette). Ce séminaire de zoopoétique s’articule en deux parties. Une première partie théorique encouragera à réfléchir aux différents problèmes stylistiques, sémiologiques, éthiques et diplomatiques que soulève toute tentative d’écrire (sur) les vivants : anthropocentrisme versus anthropomorphisme, traductions interspécifiques et échanges entre sémiosphères, appropriation biologique et exploitation, fétichisation et réparation symbolique, etc. (C. Marcandier et JcCavallin). À partir de quelques protocoles définis au cours de cette première partie, une seconde partie proposera une initiation à la conduite d’ateliers d’écriture en ligne (Boris Le Roy).
➽ Dans le cadre de ce séminaire, un atelier en ligne sera conduit par Geneviève de Bueger, ancienne étudiante du master et autrice de lectures-performances écopoétiques.
Bibliographie. • David Abram, Devenir animal. Une cosmologie terrestre, Dehors, 2024. • Vinciane Despret, Autobiographie d’un poulpe, Actes Sud, 2021. • Donna Haraway, Manifeste des espèces compagnes, Climats, 2003. • Joseph de Pesquidoux, Chez nous. Travaux et jeux rustiques [1912-1922], Plon, 1980. • João Guimarães Rosa, Mon oncle le jaguar et autres histoires, Chandeigne, 2016. • Anne Simon, Une Bête entre les lignes. Essai de zoopoétique, Wildproject, 2021. • Miguel Torga, Bestiaire, Chandeigne, 2022.

Quelles révolutions l’ère numérique entraîne-t-elle dans la production et dans la diffusion des textes de fiction et de théorie ? Le cours se propose d’étudier la manière dont Internet, les journaux « sans papier », le numérique, les blogs et les réseaux sociaux ont profondément modifié l’accès au savoir et aux textes. Pensé comme un espace utopique de libre circulation et de partage gratuit des savoirs, susceptible de fonder une communauté virtuelle (le « village planétaire » de Marshall McLuhan), le web a été largement récupéré par la logique capitaliste des GAFA, Bouleversement du savoir et de sa diffusion, Internet est désormais l’espace disjonctif ou « oxymorique » (Bernard Méheust) du e-commerce comme des plateformes participatives, de la vente en ligne comme de l’open access (archives ouvertes, téléchargements, green access).
Cet « écosystème numérique » (Bonnet, 2017) est très présent dans la production littéraire contemporaine. De Don DeLillo à Pierre Ducrozet, la fiction se penche sur ces nouvelles machines et ces nouveaux habitus qui modifient en profondeur la forme, la nature comme la diffusion des textes (présence des écrivains sur les réseaux, blogs, sites, etc.). Après avoir brièvement rappelé une histoire du net, contextualisé ses principaux acteurs et commenté le paradoxe de sa « virtualité » (très matérielle), ce cours étudiera la littérature à l’ère numérique. Quel devenir pour le support imprimé, quelles révolutions dans les domaines de la diffusion, de l’édition et de la réception des textes ? Quelles mutations dans les poétiques contemporaines ?
Bibliographie : • Gilles Bonnet, Pour une poétique numérique. Littérature et internet. Hermann, 2017. • Jean-François Fogel et Bruno Patino, La Condition numérique. Comment Internet bouleverse nos vies, Points, 2014 (Grasset, 2013) • Kenneth Goldsmith, L’Écriture sans écriture. Du langage à l’ère numérique (Uncreative Writing. Managing Language in the Digital Age, 2011), trad. de François Bon, Jean Boîte éditions, 2018. • Jean-Baptiste Malet, En Amazonie. Infiltré dans « le meilleur des mondes », Pluriel, 2015. • Shoshana Zuboff, L’Âge du capitalisme de surveillance, trad. Bee Formentelli et Anne-Sylvie Homassel, Zulma Essais, 2020.
(image : Bruxelles, 2020 © Christine Marcandier)


Bonjour à tous
Le cours Sfad de Géopolitique commencera la semaine du 22 janvier 2024
Serge Schwartzmann
Bonjour à toutes, tous!
Bienvenu dans ce cours SFAD "Dynamiques urbaines mondiales" qui commencera la semaine du 23 septembre.
Les éléments de cours sont mis sur Ametice entre le lundi et le mercredi soir chaque semaine.
Chaque semaine, Vous aurez une power-point de cours, un TD avec des exercices, des documents annexes à lire.
Comme toutes les UE au Sfad, vous n'aurez qu'une seule note en contrôle final, durant les épreuves de janvier, entre le 13 et le 25 janvier 2025. La date sera communiquée ultérieurement.
Les CM et TD sont dispensés par Serge Schwartzmann.
Pour toute question => serge.schwartzmann@univ-amu.fr